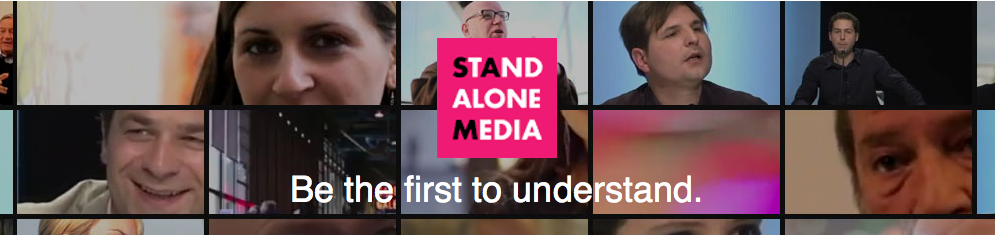
Entretien d’Anne Bocandé avec Karim Amellal
 Auteur, chargé de cours, Karim Amellal multiplie les expériences pour combattre les inégalités et rendre accessible le savoir au plus grand nombre. Avec Stand Alone Media, il lance une télévision sur Internet ayant pour but la vulgarisation et la valorisation des savoirs scientifiques. Rencontre avec un curieux tous azimuts.
Auteur, chargé de cours, Karim Amellal multiplie les expériences pour combattre les inégalités et rendre accessible le savoir au plus grand nombre. Avec Stand Alone Media, il lance une télévision sur Internet ayant pour but la vulgarisation et la valorisation des savoirs scientifiques. Rencontre avec un curieux tous azimuts.
Pouvez-vous définir le projet de Stand alone media, [sam.tv] -?
Si on devait simplifier, il s’agirait de créer une espèce de Wikipédia vidéo, une encyclopédie participative mais très qualitative centrée sur un savoir encyclopédique. Notre ambition est de rendre accessible la connaissance au plus grand nombre, avec des sujets de fond, essentiellement dans le domaine du savoir et de la création. Pour atteindre cet objectif nous produisons des émissions d’une quinzaine de minutes avec des modules pédagogiques.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas saisi des médias actuels plutôt que d’en créer un nouveau ?
Nous sommes issus majoritairement du milieu universitaire. Nous y avions pensé. Mais tout est parti d’une double frustration. D’abord nous en avions marre de voir défiler des tas de gens passionnants mais qu’on ne retrouverait pas dans les médias conventionnels. Deuxièmement, on se rendait compte que la télévision, à travers des formats, des modes de compression, le recours à une fausse expertise, n’offre pas de canaux susceptibles d’accueillir ce type de contenu. La télévision comprime, préfabrique, formate. On a donc fait le pari du web. En matière de pédagogie, beaucoup de choses existent en écrit mais très peu en vidéo. Créer une sorte d’encyclopédie vidéo avait alors du sens. Nous ne sommes tributaires d’aucun format : si un sujet requiert 10 ou 20 minutes, on s’en fiche. Et la vidéo est le médium le plus accessible.
Est-ce qu’il y a un besoin des universitaires de diffuser plus largement et différemment leurs travaux ?
Les universitaires doivent s’emparer de la vidéo et certains ont commencé à le faire, aux États-Unis, au Japon et ailleurs en Europe. Nous sommes en retard en France. Il y a un certain nombre de données qui existent : on sait que les jeunes, les 15 – 25 ans regardent de moins en moins la télévision et écoutent de moins en moins la radio. Surtout en matière de recherche d’information, ils vont davantage sur le web. Chez un adolescent de 15 ou 16 ans actuellement, le temps de télévision est un temps de télévision forcé et non choisi. C’est une donnée essentielle pour nous. Mais personne ne peut anticiper sur ce qui sera dans cinq ans. Il y a des évolutions technologiques incroyables.
Dans très peu de temps, sur un écran de télévision, les contenus viendront du web. L’idée est donc de se positionner très rapidement sur un contenu vidéo, qualitatif sur le fond et sur la forme pour que lorsque ces évolutions technologiques arriveront — ce n’est qu’une question de mois ou de petites années — être en situation d’offrir une plate-forme de contenus.
Comment est accueilli sam.tv dans le milieu universitaire ?
Il y a un vrai problème de communication des travaux scientifiques français depuis les années cinquante. Nos chercheurs ne sont pas formés pour sortir de leur laboratoire et pour parler au public, La responsabilité n’incombe pas aux chercheurs. La plupart ne demandent que ça. C’est la raison pour laquelle on se définit comme un slow media. Toutes nos émissions sont très travaillées en connivence avec nos invités qui sont des chercheurs, des scientifiques. Lorsqu’on interviewe un chercheur, on ne va pas lui poser des questions auxquelles il ne s’attend pas. Notre objectif est pédagogique : expliquer un objet scientifique, le décortiquer, l’analyser et le faire comprendre.
On ne se considère pas comme des journalistes. Nous ne sommes pas non plus des universitaires. Nous sommes des accoucheurs. Ce qu’on fait n’est rien d’autre que de la maïeutique. Pourquoi est-ce qu’on choisit la forme de l’entretien ? Nous ne pouvons pas demander à un chercheur ou Professeur de monter sur une estrade pour faire un speech de 10 minutes. On peut le déplorer mais ils ne sont pas formés pour ça contrairement aux Américains ou à d’autres.
- [Le format Ted]- n’est pas valable en France d’où la catastrophe des Ted’X université. La qualité de ses interventions va inévitablement décroître parce que c’est toujours les mêmes qui vont se succéder. Parce qu’en France il doit y avoir dix chercheurs susceptibles de faire un speech génial pendant trois quarts d’heures.
Donc il a fallu trouver autre chose et cet autre chose est vieux comme le monde, c’est l’entretien, la maïeutique. Essayer de poser les bonnes questions à des gens qui ont la légitimité requise pour entrer dans cette démarche pédagogique et offrir un discours qui soit audible, compréhensible, explicite par le plus grand nombre.
Comment choisissez-vous vos sujets ?
D’abord on choisit de faire ce qui nous plaît. J’adore l’astrophysique et la médecine et j’ai très envie de faire des émissions là-dessus. Concrètement, pour créer un Wikipédia vidéo, il faut avoir beaucoup de contenus et donc être très curieux. Il ne faut refuser aucun type de sujets de l’histoire du fromage aux stratégies d’équipe du tour de France. Nous sommes complètement pluridisciplinaires.
La ligne éditoriale est simple : prendre le temps de faire comprendre des sujets compliqués au plus grand nombre.
Nous sommes donc a priori partants pour tous les sujets. Après, on va déployer notre infrastructure pédagogico-médiatique, c’est-à-dire qu’on va chercher les bons chercheurs, qu’on va consulter le comité éditorial, on va mettre en place une équipe de journalistes qui va creuser les contenus. C’est fondamental. Le journaliste — qui n’est ni universitaire ni chercheur — va tout lire sur le sujet. Quand je prépare une émission, par exemple sur les exoplanètes, je lis dix bouquins qui en parlent, des articles, je rencontre des gens. Bref, un vrai travail journalistique d’investigation, ce que personne à la télévision aujourd’hui ne fait (je ne parle pas d’Arte ni de France 5) y compris dans les émissions culturelles. Je l’ai vu quand j’ai publié Cités à comparaître par exemple. Les animateurs recevaient le bouquin deux minutes avant mais se rassuraient en disant qu’on leur avait fait des fiches.
La presse écrite, c’est différent. Mais la télévision, c’est quand même ce qu’il y a de pire dans le traitement et l’appréhension d’un contenu.
On est très attentif aussi à ne pas subir l’effet pervers : ne pas produire un contenu indigeste. D’où le travail que nous essayons de faire sur la forme ; nous tournons parfois à l’Opéra, au Palais de Tokyo, au Centre Pompidou… Être digeste et captivant est un effort sur le fond comme sur la forme.
Vous privilégiez aussi le côté participatif.
Nous avons développé le côté participatif pour que les publics, s’ils ne contribuent pas à la production du contenu, puissent y accéder, le partager, le récupérer, le commenter évidemment, proposer des ressources documentaires, s’approprier l’ensemble du module pédagogique.
Quel est votre modèle économique ?
Aucun abonnement, aucune adhésion à l’entrée. Typiquement, pour nous, le modèle Médiapart n’est pas bon. Il fallait qu’on trouve un business économique fiable. Wikipédia vidéo c’est bien mais c’est de la philanthropie. Il fallait qu’on valide notre business model sans être demandeur de subventions. Hors de question de demander au CNC ou à des collectivités. C’est philosophique et politique. La communauté nationale n’a pas à payer pour qu’on produise des contenus de ce type. Ceux qui doivent payer sont les entreprises sous forme d’une publicité. C’est ce que nous avons appelé la vidéo parrainée ou le sponsor embarqué. Les émissions sont parrainées ou sponsorisées par des marques qui n’interviennent pas dans le contenu mais qui s’associent à un contenu à haute valeur ajoutée intellectuelle, qui entre en résonance avec leurs préoccupations. Un sponsor qui vient avec nous est assuré de ne pas être périmé en l’espace de 48 heures Quand on explique la formation du système solaire, il y a peu de chances que notre émission ne soit plus regardable six mois après. De plus, nous sommes associés à Google, donc notre émission a une audience cumulative. Elle est de mieux en mieux classée car il n’existe pas encore d’émissions de ce type sur Internet. Deuxièmement, la marque est assurée d’être associée sur une pluralité de supports. Notre modèle économique repose là-dessus. N’importe quel média peut s’approprier notre contenu. Les Échos, le Guardian mais aussi France24 l’ont déjà fait. C’est gratuit pour eux, parce que ce sont précisément les marques qui financent. On inverse le système. D’habitude les boites de production produisent puis vont vendre leurs contenus alors que nous, nous préfinançons nos émissions.
Comment et par quoi une entreprise va se montrer intéressée par un contenu en particulier ?
Les entreprises ont toujours un ou des problèmes à régler. Nous, on essaie de régler ces problèmes. Exemple : la RATP a une image désastreuse auprès des Parisiens. Deuxièmement : elle a un problème de recrutement d’ingénieurs qui vont plutôt à la SNCF qu’à la RATP. Troisièmement elle a un problème de notoriété à l’international, or elle a 20 % de son marché à l’international. Nous l’aidons à régler ces problèmes. Il n’y a donc aucune raison qu’ils ne sponsorisent pas des émissions sur l’histoire de la politesse ou sur un grand artiste. Ces émissions vont contribuer à améliorer leur image de marque. De la même manière pour le recrutement des ingénieurs, qu’ils soutiennent une émission sur le système solaire qui pourra intéresser des élèves en école d’ingénieurs. Ainsi la marque RATP peut se valoriser avec des contenus positifs sans intervenir dessus. De plus, les entreprises acquièrent des droits d’exploitation non commerciale de l’émission. Nous leur proposons un contenu non corporate à haute valeur ajoutée intellectuelle.
L’essentiel est que le contenu ne soit pas en lien direct avec l’activité principale de l’entreprise.
Pourquoi segmenter un contenu généraliste en plusieurs tv avec Stand alone media Arabia (samar.tv) ?
Nos déclinaisons régionales sont essentiellement linguistiques. Une de nos obsessions depuis le début, est de sortir des frontières de la France le plus rapidement possible en particulier avec l’anglais. C’était donc l’occasion de produire en anglais, en arabe et en français.
La deuxième raison est qu’il y a des sujets propres à certaines zones linguistiques qui requièrent un traitement particulier. Par exemple une émission sur l’armée en Égypte a plus de sens si elle est hébergée sur un média ancré sur le fond et linguistiquement dans la zone.
C’est exactement le même concept éditorial, la même charte, mais la production se fait dans la zone. On ne peut pas prétendre apporter du sens à la région en étant basé à Paris. Philosophiquement et politiquement parlant il faut être au centre du dispositif, cela veut dire être dans le monde arabe, produire en arabe, travailler avec des universités arabes, avec des chercheurs arabes etc.
Quelles sont les perspectives de développement de sam.tv à l’international ?
Dans notre idée de départ, c’était “on va transmettre la franchise à des groupes d’étudiants qui vont développer, déployer le concept à partir de leur zone”. On a toujours un peu ça en tête. Pour l’Afrique, les États Unis, l’Asie. On tient vraiment à ce qu’il y ait un ancrage local et une adaptation du modèle des sujets aux exigences locales, des universités, du public et des sponsors.
Karim Amellal, vous êtes chargé de cours à Sciences Po Paris, auteur, chroniqueur. Quelle est votre casquette ?
Je fais plein de trucs qui me plaisent avec des grandes thématiques. La première est cette obsession de rendre accessible un contenu quel qu’il soit, que ce soit à travers le collectif Qui fait la France ? ou quand on est écrit des livres. On veut être lu et compris. C’est vraiment le trait d’union de mon parcours. Aujourd’hui je suis associé fondateur de Sam. Je suis maître de conférences à Sciences Po, je donne des cours sur le multiculturalisme et diversité culturelle.
C’est un lieu commun de dire ça mais j’ai toujours eu un souci de liberté. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas assujetti à un ordre ou à un établissement. Et d’autant plus avec sam.tv car on est maître de notre destin.
Vous vous exprimez quelque part comme un anglophone, non-formaté par le système universitaire français assez cloisonné.
Je suis fasciné par leur système universitaire même s’il a ses limites. Faire ce qui me plaît. C’est d’ailleurs passionnant de voir à quel point le monde universitaire et professionnel dans le monde anglophone s’aère en permanence. L’histoire de Google est un bel exemple. Il n’y a pas comme ici, à Paris, dans cette ignoble ville que j’adore par ailleurs, ces systèmes de cercles et de confinement de l’information, de castes, qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Impossible de parler de correspondance, de passerelle, de transdisciplinarité en France.
La diversité culturelle est un terme que vous employez souvent. Que mettez-vous derrière ce terme ?
Philosophiquement d’abord on n’est jamais plus fort et surtout jamais meilleur que lorsqu’on rencontre l’autre, lorsqu’on se nourrit de l’autre. C’est valable entre des individus qui sont de milieux sociaux différents, de milieux de dimension culturelle différente, mais aussi entre la banlieue et le centre de Paris et entre la France et l’Algérie. Ce qui ressort de ça est toujours supérieur à la somme de ces deux individualités ou à ce que chacun vaut chacun dans son coin. C’est mon axiome depuis toujours, à travers mon expérience personnelle parce que j’ai vu que je m’enrichissais même à travers des expériences un peu minables, que je ressortais toujours avec quelque chose en plus, pour peu qu’on sache profiter, bénéficier de cette superposition d’acquis, d’expérience, de parcours. C’est pour cela que bâtir des passerelles entre les univers me tient particulièrement à cœur.
Donc vous ne faites pas référence au terme politique actuel de la diversité culturelle qui stigmatise certaines franges de la population ?
Pas du tout. J’appréhende cette notion non pas à travers le concept de mélange ni de métissage, mais ceux de communication et d’interaction positive.
Mais c’est sûr que l’histoire du concept de diversité à travers sa naissance, sa mise en œuvre, par des politiques d’affirmative action aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, à travers sa transposition assez dramatique en France produit aujourd’hui des ravages, le contraire de l’effet escompté tout au départ. Il y a tout un tas de raisons qui font qu’aujourd’hui le concept a perdu de sa substance et est un concept qui veut tout et rien dire. Je passe mon temps à déconstruire cette notion.
Mais vous êtes moins actuellement dans la démarche politique comme vous l’étiez avec le livre Discriminez-moi et Cités à comparaître ?
Aujourd’hui je n’écrirais pas du tout le même texte et je n’utiliserais pas la notion de diversité de la même manière que dans Discriminez-moi. Le concept a énormément évolué. Il a une genèse très récente en France. Il est arrivé en 2002 – 2003, via les institutions européennes. Si on a un droit antidiscriminatoire aujourd’hui qui est à peu près cohérent, même si pas très efficace, c’est la loi de 2001 qui est la conséquence de deux directives européennes de 2000. Les choses avancent. Le droit communautaire a fait son œuvre. La Halde continue d’exister dans le défenseur des Droits, qui a davantage de pouvoirs.
Le temps plus fondamentalement fait son œuvre, si on prend des critères comme le nombre de mariages mixtes par exemple. Le destin des générations d’immigrés est un destin qui est ascensionnel quel que soit le critère que l’on prend.
Évidemment, je faisais partie de ceux qui souhaitaient que cela aille plus vite.
Pourquoi vous utilisez le passé pour parler de vos engagements ?
Je pense qu’il ne faut pas brusquer les choses sur ces notions, dans un pays comme la France. Nous avons une histoire politique très particulière. Si j’avais un mea culpa à faire c’est d’avoir pensé que des concepts venus d’ailleurs pouvaient accélérer le cours des choses, produire des choses positives en moins de temps que nécessaires. J’ai toujours considéré que la discrimination positive telle qu’elle était mise en place ailleurs était excessive. Mais un compromis était cette notion de diversité. Mais elle est incontestablement, pour des raisons historiques, politique, philosophique, trop éloignée de notre tradition politique. Nous sommes dans un pays d’unité, d’égalité. La diversité explose ces deux notions qui sont les fondements de tout notre édifice politique, intellectuel, juridictionnel, institutionnel.
On est français ! On est encore révolutionnaire dans l’âme ! On a pensé qu’en adaptant cette notion, en la dépeçant de ses oripeaux anglo-saxons on pouvait faire avancer certaines choses, notamment la question des discriminations. C’était sans doute une erreur.
Vous dites que les États-Unis ne sont pas nécessairement un modèle à prendre mais ce pays est pourtant un modèle pour de nombreux jeunes issus des quartiers populaires qui ressentent de profondes discriminations dans leur quotidien.-
Tout à fait. Mais je pense que ça ne sert à rien mais c’est même contre-productif de chercher à importer ici des choses qui sont complètement contradictoires, par rapport à ce qu’on est à ce qu’on fait. Pour la littérature et la non-reconnaissance de la littérature en France, cela ne sert à rien de regarder ce qui se fait ailleurs. Les causes sont ici. Il s’agit de faire évoluer, non pas la littérature en soi, mais ceux qui la produisent et la fabriquent c’est-à-dire les maisons d’édition. Nous avons des maisons d’édition et un système d’édition qui n’a pas bougé depuis le XIXe siècle. Ça ne peut plus durer.
Vous êtes donc plus patient, plus assagi que dans vos premières publications ?
Je suis plus patient. Le truc c’est qu’il ne faut pas oublier ce qui s’est passé en 2005, à l’heure où j’ai publié mes premiers textes. C’était les émeutes. Est-ce qu’on est aujourd’hui dans une situation d’urgence telle qu’on doit exploser les lignes existantes en matière de discriminations par exemple ? La réponse est non parce que les conséquences, en période de crise, seraient bien plus terribles en réalité que d’essayer d’agir sur d’autres variables, comme l’emploi par exemple.
Vous ne pensez donc pas que les révoltes sociales pourraient de nouveau émerger, notamment si la gauche n’est pas à la hauteur des espoirs suscités ?
Si. Mais c’est pour ça que je suis content que la gauche soit passée. Et pour la question du délit de faciès par exemple, c’est important mais le récépissé relève du symbole. Fondamentalement le problème actuel est celui de l’emploi, de l’accès aux loisirs, aux transports. Alors évidemment ce sont des symboles qui comptent mais il ne faut pas des politiques publiques de saupoudrage. Il ne faut pas que cela fasse oublier le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c’est l’égalité des chances, c’est la réussite scolaire. Et donc on revient sur l’accès au savoir et à la culture. De cette manière on peut faire communiquer les territoires, tous les territoires, notamment les zones rurales et urbaines. La diversité c’est aussi ça.
J’ai cette chance, ma mère est de l’Indre, d’un village où j’ai vécu et donc j’ai vécu dans ces deux mondes. C’est ce qu’on a essayé de faire avec le collectif, on a été en campagne, en montagne. Mes collègues étaient chamboulés car ils se retrouvaient devant des gens qui avaient les mêmes problèmes qu’en ville, de problème de rapport à l’écriture, d’accès à la lecture, d’enclavement intellectuel et culturel. Ils sont pareils. Alors bien sûr que les contrôles au faciès sont importants, mais fondamentalement et à long terme ce qui compte c’est d’avoir une école qui fonctionne. Un élève sur deux qui redoublent n’aura pas son bac. Alors évidemment. Dans les quartiers populaires — zones rurales et urbaines sensibles — ce sont deux élèves sur cinq.
Et puis pourquoi les écoles de commerce ne s’ouvrent-elles pas davantage ? Pourquoi est-ce que les classes prépas créent des sas ? C’est là-dessus qu’il faut travailler. Et on peut travailler là-dessus avec tout le monde pour s’adresser de la même manière à une personne d’Aubervilliers qu’à une personne de Bretagne.
J’essaie d’intégrer cette réflexion personnelle sur une réflexion plus vaste sur la société française et de trouver les meilleurs moyens de faire avancer les choses. Et les seuls moyens c’est la communication.
Source de l’article : africultures

